Analyse du livre Eléments de philosophie
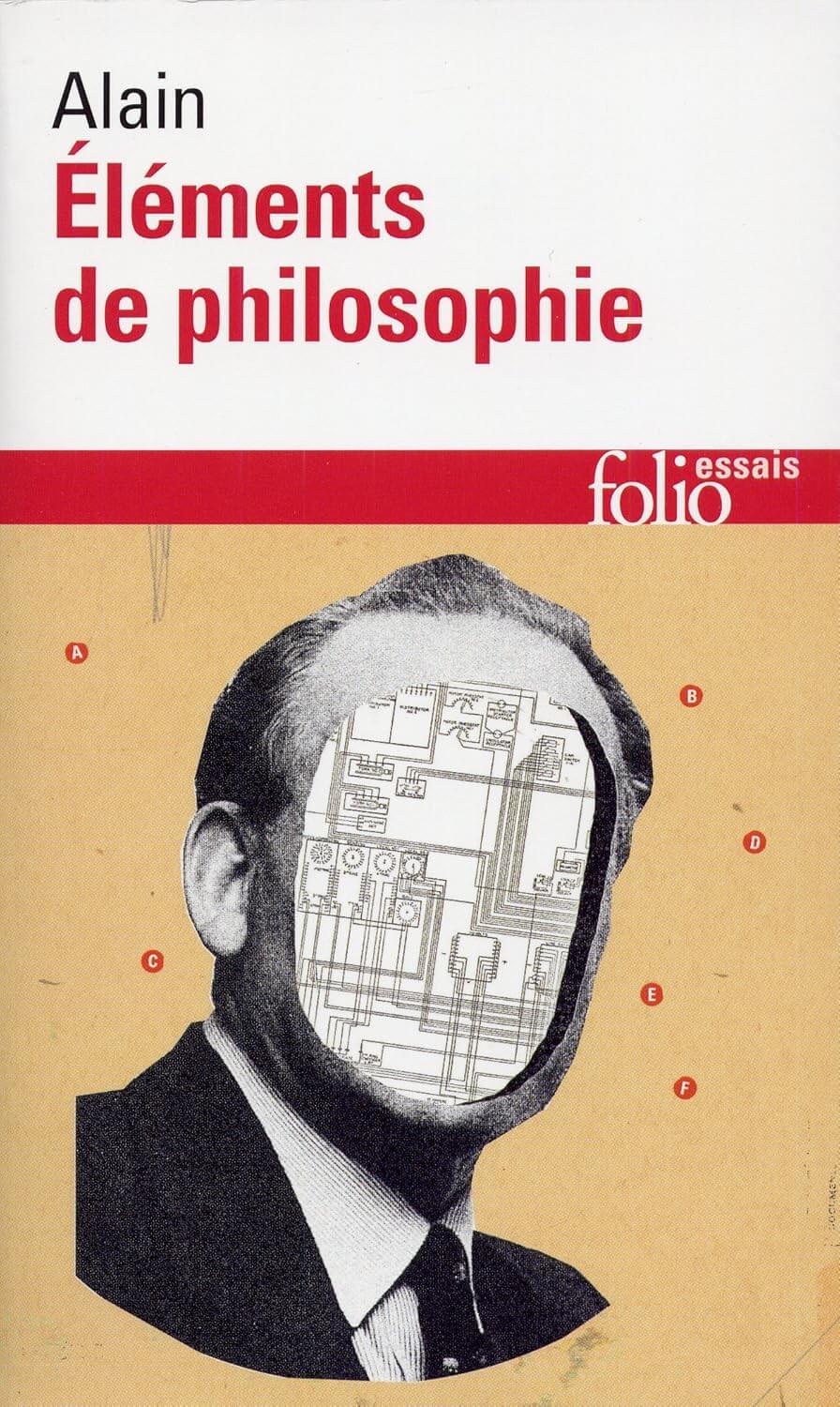
Il y a quelques années, j’avais lu quelques livres intéressants du philosophe Alain (Emile Chartier). J’avais lu plusieurs ouvrages qui m’avaient semblé plutôt clairs comme « Propos sur le bonheur » ou « Mars et la guerre jugée ». J’ai donc acheté un livre représentant apparemment une sorte de synthèse de la pensée d’Alain. Ce livre c’était « Eléments de philosophie » (téléchargeable au format pdf ici). Nous étions peut-être en 2018 ou 2019 et je souffrais encore énormément : je n’avais ni l’énergie ni l’envie de lire un livre de philosophie illisible, incompréhensible. Aussi, de mémoire, j’étais déçu par le début de l’ouvrage d’Alain car je ne comprenais rien et je m’ennuyais. J’ai donc regardé la table des matières et j’ai choisi le thème qui m’inspirait le plus ce jour-là : « du jugement » (première partie du livre quatrième nommé « De l’action »). Je voulais savoir ce qu’Alain avait à dire du jugement dans le contexte des persécutions quotidiennes que j’endurais. Je commençais donc le livre quatrième plus ou moins par hasard, sans avoir lu les précédents.
Assez rapidement, dans un contexte d’épuisement psychique et de peur, un canal de communication (d’interprétation délirante dirait un psychiatre) se mettait en place à la lecture des mots écrits par Alain. Ses propos sont assez décousus : il ne faut pas vouloir en extraire un sens évident mais au contraire, laisser les phrases nous pénétrer et engendrer des pensées. Ainsi à chaque lecture de ce livre quatrième (que j’ai relu pour l’occasion en écrivant ces lignes), une interprétation, une histoire différente « dans la tête » va se mettre en place et c’est comme cela, à mon avis, qu’il faut lire Alain quand on n’est pas suffisamment intelligent -- ce qui est mon cas -- pour le lire autrement. Je commençais donc le livre quatrième en espérant qu’Alain me donnerait quelques éléments de philosophie pour savoir s’il fallait que je juge mes persécuteurs, si oui, comment, si non, pourquoi etc… Alain m’accompagna, comme vous allez le voir, sur un tout autre chemin. Je vais coller quelques passages : ne cherchez pas à extraire un sens clair mais faites comme moi, laissez les mots rentrer en vous puis posez-vous constamment la question : mais de quoi parle-t-il ? Dans la suite de mon propos, le texte d’Alain est en italique, le mien en police normale.
« Que l’esprit reçoive la vérité comme la cire reçoit l'empreinte, c'est une opinion si aisée à redresser que le lecteur la considérera avec mépris peut-être. Elle règne pourtant sur presque tous les livres, et sur tous les esprits qui n'ont pas assez inventé en s'instruisant. La faute en est au premier enseignement, qui n'a jamais assez d'égard pour ces erreurs hardies que l'esprit enfant formerait par ses démarches naturelles. Le plus ferme jugement, dès qu'il s'essaie, se trouve pris dans des preuves irréprochables, jusqu'à ne pouvoir même en changer la forme, par l'impossibilité de mieux dire. »
Il sera question dans cette partie de « preuves » mais de preuves de quoi ?
« Même importunés, même écoutant et comprenant les parties, ils savent ne pas les lier et faire tenir debout par cette attention décisive que le marchand de preuves guette dans leurs yeux. Tous les éléments de ce monde qui allait naître retombent au chaos, faute d'un créateur. Semblable à ces lutteurs, toujours prudents à saisir ce qu'on leur offre. On réfléchit mal dans une prison de preuves. D'autres craignent les fausses preuves, eux la vraie. Jeu de prince. »
Cher lecteur, vous y comprenez quelque chose ?
« On ne juge pas comme on veut, mais on ne juge que si on veut. Les naïfs se demandent comment on peut se refuser aux preuves ; mais rien n'est plus facile. Une preuve ou une objection n'ont pas même assez de mon consentement ; il faut que je leur donne vie et armes. Les consentements faciles nous trompent là-dessus. Pour moi, j'observe souvent qu'une preuve connue, reçue même en son entier, recopiée même, je dis une preuve des sciences exactes, reste comme un corps mort devant moi. Je la sais bonne, mais elle ne me le prouve point ; c'est par grand travail que je la ressuscite ; plus je me laisse aller, moins elle me prend. Mais aussi elle est neuve à chaque fois qu'elle renaît. Naïve à chaque fois. Si vous n'êtes pas ainsi, prenez Platon pour maître. »
« Les prêcheurs de toute foi ont bien compris ces choses, mais sur d'autres exemples. Dès qu'il s'agit de vertu ou de perfection, ceux qui y pensent un peu ont bientôt compris que ces choses-là, qui justement ne sont point, ne sont point pensées si elles ne sont voulues, et, bien mieux, contre les leçons de l'expérience. Aussi disent-ils bien que la bonne volonté doit aider les preuves et que Dieu ne se montre qu'à ceux qui l'en prient. Mais ils ne le découvrent que par les effets extérieurs, voulant toujours un Dieu qui existe à la manière du monde, mais caché. Il est pourtant assez clair que la justice entre les hommes n'existe pas, et qu'il faut la faire. »
Apparemment, le texte traite de la preuve de Dieu. Mais pourquoi ? Et pourquoi Alain écrit de manière énigmatique, enrobe son sujet dans le flou ? Cherche-il à ne s’adresser qu’à certain lecteur ? A en faire fuir d’autres ? Car comme je l’ai expliqué, quand Alain veut écrire de manière nette et précise, il sait très bien le faire : dans l’ouvrage Mars ou la guerre jugée par exemple (téléchargeable au format epub ici).
« La prédiction d'un devin ou d'une sorcière, si elle dépend de causes extérieures et inanimées, peut se trouver vérifiée soit par hasard, soit par l'effet d'une connaissance plus avancée des signes, soit par une finesse des sens qui permet de les mieux remarquer. Il faut dire là-dessus qu'on oublie presque toutes les prédictions ; ce n'est souvent que leur succès qui nous les rappelle. Mais le crédit qu'on apporte aux prophètes tient à des causes plus importantes et plus cachées. Souvent l'accomplissement dépend de nous-mêmes ou de ceux qui nous entourent ; et il est clair que, dans beaucoup de cas, la crainte ou l'espérance font alors arriver la chose. La crainte d'un accident funeste ne dispose pas bien à l'éviter, surtout si l'on penche à croire qu'on n'y échappera pas. Mais si c'est la haine d'un homme que je crains, ou seulement l'attaque d'un chien, l'idée que j'en ai s'exprime toujours assez pour faire naître ce que j'attends. Si l'avenir annoncé dépend de moi seul, j'en trouverai bientôt les signes en moi-même ; le bon moyen d'échapper au crime, à la folie, à la timidité, au désir de la chair ou simplement à la sottise n'est certainement pas d'y toujours penser. En revanche, croire que l'on est sauvé du mensonge ou de l'envie, ou de la brutalité, ce n'est pas un faible secours. Par ces causes, l'autorité des prophètes n'est pas près de finir. »
[…]
Et le proverbe dit de même que l'homme qui est né pour être noyé ne sera jamais pendu. Au lieu que, selon le déterminisme, le plus petit changement écarte de grands malheurs, ce qui fait qu'un malheur bien clairement prédit n'arriverait point. Mais on sait que le fataliste ne se rend pas pour si peu. Si le malheur a été évité, c'est que fatalement il devait l'être. Il était écrit que tu guérirais, mais il l'était aussi que tu prendrais le remède, que tu demanderais le médecin, et ainsi de suite. Le fatalisme se transforme ainsi en un déterminisme théologique ; et l'oracle devient un dieu parfaitement instruit, qui voit d'avance les effets parce qu'il voit aussi les causes. Il reste à disputer si c'est la bonté de Dieu ou sa sagesse qui l'emportera. Ces jeux de paroles sont sans fin, mais l'expérience la plus rigoureuse semble décider que le Créateur ne change jamais le cours des choses, et reste fidèle aux lois qu'il a instituées. Par ce détour, on revient à dire que l'homme qui sera noyé par des causes ne sera certainement pas pendu. Au lieu d'être attiré par un destin propre à lui, il est pris dans une immense machine dont il n'est qu'un rouage. Sa volonté elle-même suit ses actions ; les mêmes causes qui le font agir le font aussi vouloir. Chacun sait qu'une certaine espèce de fous font ce qu'on leur suggère, et qu'ils veulent aussi ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils croient faire ce qu'ils veulent. Prouvez que nous ne sommes pas tous ainsi.
Ce qui achève d'engourdir l'esprit, c'est que, par un déterminisme bien éclairci, tout reste en place. Un bon conseil est toujours bon à suivre, que je le suive par nécessité ou non. La délibération n'est pas moins naturelle, soit que je pèse les motifs avant de me décider librement, soit que je cherche à prévoir, par l'examen des motifs, ce que je ferai par nécessité. La décision a le même aspect, soit que je jure de faire, soit que je sois sûr que je ferai. Les promesses aussi. L'action aussi, l'un disant qu'il a fait ce qu'il a voulu, l'autre qu'il a voulu justement ce qu'il ne pouvait pas ne pas faire. Ainsi le déterminisme rend compte des sentiments, des croyances, des hésitations, des résolutions. La sagesse, disait Spinoza, te délivre et te sauve autant, que ce soit par nécessité ou non. Sur quoi disputons-nous donc ?
Remarquez ici, dans la dernière phrase, qu’Alain passe au tutoiement et interpelle directement le lecteur « Sur quoi disputons-nous donc ? » autrement dit Alain demande au lecteur : de quoi sommes nous en train de discuter réellement ? Pourquoi Alain franchit-il le quatrième mur ? c’est-à-dire pourquoi fait-il usage de métalepses narratives : brouiller les niveaux de récit, en faisant interagir des plans normalement séparés ?
[…]
« Je ne dispute point. Je contemple avec attention, sans aucun respect, ce vaste mécanisme qui ne promet rien, qui ne veut rien, qui ne m'aime point, qui ne me hait point. L'esprit qui le contemple me paraît au moins son égal, pénétrant même en lui au delà de ce qu'il montre, et, s'il ne le dépasse point en étendue, l'égalant toujours. Non que l'esprit me semble s'étaler sur les choses, et se diviser et disperser pour les saisir, au contraire, c'est par l'unité de l'esprit, sans parties ni distances, qu'il y a des parties et des distances ; car la partie par elle-même n'est qu'elle, et n'est donc point partie ; et la distance entre deux parties leur est extrinsèque aussi. Il n'est donc pas à craindre que cette âme sans parties et qui comprend toutes choses, aille s'enfermer dans quelque trou de taupe. Réfléchis un moment ; si ton âme était dans ton corps, elle ne pourrait point penser la distance de ton corps à d'autres. L'ouvrier de ce grand réseau, il faut qu'il y soit partout à la fois et tout entier partout ; comment y serait-il pris ? N'aie pas peur. Fie-toi à ton âme. »
A nouveau le tutoiement ici et l’adresse directe au lecteur : mais pourquoi ?
« Mais ne craignez pas d'être libres malgré vous ; je n'y puis rien. Ici est la foi dans sa pureté ; ici apparaissent les preuves théologiques, si longtemps détournées de leur objet propre, car c'est la Foi même qui est Dieu. Il faut croire au bien, car il n'est pas ; par exemple à la justice, car elle n'est pas. Non pas croire qu'elle est aimée et désirée, car cela n'y ajoute rien ; mais croire que je la ferai. Un marxiste croit qu'elle se fera sans nous et par les forces. Mais qu'ils suivent cette idée ; cette justice qui se fera n'est même plus justice ; ce n'est qu'un état des choses ; et l'idée que je m'en fais, de même. Et si tout se fait seul, et ma pensée aussi bien, aucune pensée non plus ne vaut mieux qu'une autre, car chacun n'a jamais que celle qu'il peut avoir par les forces. Et notre marxiste doit attendre qu'une vérité aussi en remplace une autre. J'ai connu de ces penseurs qui se laissent penser comme d'autres se laissent vivre. Le vrai penseur ce serait donc le fou, qui croit ce qui lui vient à l'esprit ? Mais remontons de cet enfer. Il faut bien que je laisse le malade qui ne veut pas guérir. »
Notez la phrase « Mais remontons de cet enfer. Il faut bien que je laisse le malade qui ne veut pas guérir ». Cher lecteur, essayez d’être parfaitement honnête avec vous. Cette dernière phrase a été écrite par Alain. Elle signifie donc quelque chose. Mais quoi ? Quelqu’un est descendu dans cet enfer avec Alain, dans un certain contexte, un certain jour J il y a quelques années avec la faculté de le suivre très précisément. Moi. C’est avec ce genre de phrase que je veux vous montrer que ce texte est un canal de transmission en T2 et que n’y rentre pas qui veut à n’importe quel moment. J’ai pu entrer dans le texte, dans le canal informatif il y a quelques années alors qu’à l’heure où j’écris ces lignes c’est un texte neutre, illisible, presque chiant. Au mieux, j’y vois un auteur abruti, méchant, brisant le quatrième mur de manière subtile sur des thèmes glauques afin d’induire des décompensations de troubles psychotiques chez un lecteur fragile (moi, il y a quelques années). Rien de plus. Et vous, que comprenez-vous de tout cela ? Il y a une forte probabilité que vous vous disiez « Bon, c’est un philosophe, il a écrit cette phrase, il avait sans doute ses raisons qui m’échappent, les philosophes sont toujours un peu tordus et il ne faut pas toujours vouloir tout comprendre ». Bref, la probabilité est forte que vous souhaitiez faire la politique de l’autruche : « ‘Je ne sais pas ce qu’il veut dire précisément et je m’en fou parce qu’il n’a pas la possibilité de me troubler, que c’est bientôt l’heure de manger et que c’est cela qui compte vraiment, pour moi, maintenant ». Reconnaissez que vous ne savez pas qui est descendu en enfer avec Alain et que vous n’avez pas vraiment envie de le savoir. Votre esprit et votre âme vous enjoignent très certainement à ne pas vous attarder sur ce point et à changer très vite de sujet. Contemplez votre âme ? Que vous dit-elle ? Je veux comprendre pourquoi Alain a écrit cette phrase : les philosophes n’écrivent pas des phrases comme cela au hasard OU PLUTOT qu’est-ce qu’il m’emmerde avec un détail insignifiant sur lequel il passe un temps infini alors que je n’ai pas que cela à faire…
« Je ne sais quel philosophe anglais, d'esprit vigoureux et libre certes, a dit que l'idée de Dieu est la plus utile aux tyrans. C'est une raison d'être athée par précaution car la liberté marche la première. Et si je crois en Dieu, j'ose dire que ce sera toujours avec prudence. C'est trop de deux juges ; il n'en faut qu'un. Ainsi jamais je ne jugerai du vrai ni du juste d'après Dieu ; mais au contraire je jugerai Dieu d'après ce que je sais du vrai et du juste. Et c'est une règle de prudence contre le dieu des gouvernements. Si vous échappez en disant que Dieu est en effet tout ce qui est vrai et juste, je veux pourtant encore que ce qui fait soit supérieur à ce qui est. Cela revient à dire que rien de ce qui est n'est dieu. Il faut que je tienne l'objet ou qu'il me tienne. Et si la perfection est adorable, que dirons-nous de celui qui la juge ? Il y a mieux encore pourtant, c'est celui qui la fait. Ma foi j'adore l'homme juste, courageux et bon dès qu'il se montre. Là-dessus, je ne crains ni dieu, ni diable. »
[…]
« Servir et honorer Dieu, cela sonne bien à l'égard du troupeau animal et du peuple des désirs. Oui le servir, mais non vouloir ou attendre qu'il nous serve. Aussi dans le fatras des livres sacrés, j'ai trouvé fortes et touchantes ces images de Dieu faible et nu et démuni, comme s'il ne donnait que ce qu'il reçoit ; de Dieu flagellé et crucifié ; de Dieu qui demande et attend, sans forcer jamais ; de Dieu pourtant qu'on n'implore jamais en vain, comme si toute la vertu de Dieu était dans la prière ; de Dieu consolateur, non vengeur. Mais la théologie gâte tout, par jeux d'imagination et de logique. Le mouvement des persécuteurs est plus juste, quoique aveugle, car ils vengent Dieu. »
[…]
« Ceux qui n'arrivent pas à aimer leurs ennemis sont ceux qui attendent un mouvement d'amitié ou de compassion. L'amour dont je parle ici est tout voulu ; il va droit à la raison enchaînée ; et les signes ne manquent jamais. C'est pourquoi cette espérance est ferme et décidée plus que l'autre, quoi- qu'elle reçoive moins de récompenses. Son nom est charité, et la sagesse théologique l'a mise avec la foi et l'espérance, au nombre des vertus, ce qui avertit assez que la bonne volonté y doit suffire, et que l'humeur la plus favorable ne les remplace point. Comme ces vertus, trop oubliées par les philosophes, ne déterminent aucun genre d'action, mais les éclairent toutes, c'est pour cela que je les mets ici comme trois lampes à porter devant soi, pour tous chemins. »
« Pour toi, lecteur, maintenant. Il y a un doute planant, qui n'est qu'incertitude. Ce n'est pas ainsi qu'il faut lire. Mais douter avec amour et foi, comme lui a fait. Douter sérieusement, non tristement. La théologie a tout gâté ; il faudrait donc gagner le ciel comme beaucoup gagnent le pain. Mais le pain que l'on gagne en chantant est le meilleur. Il y aurait beaucoup à dire sur le sérieux. Car il n'est pas difficile d'être triste ; c'est la pente ; mais il est difficile et beau d'être heureux. Aussi faut-il être toujours plus fort que les preuves. Car ce n'est rien de bon, que ces idées qui viennent à l'assaut, surtout si l'on court aux armes À ces moments-là, Socrate riait. Lecteur, au sortir de ces landes arides qu'il a bien fallu traverser, je souhaite que jeunesse te garde. »
Ce paragraphe termine le livre quatrième « De l’action » en laissant respirer un peu le lecteur, en lui proposant un peu d’Esperance. La dernière phrase « Lecteur, au sortir de ces landes arides qu'il a bien fallu traverser, je souhaite que jeunesse te garde » rappelle et insiste à nouveau sur le fait que le vrai lecteur, celui qui suit précisément le bon fil de lecture, vient de subir une épreuve difficile : il sort de landes arides qu’il a bien fallu traverser. Est-ce que vous cher lecteur sortez aussi de landes arides OUI ou NON ? Car si la réponse est NON, vous n’avez pas pu vous connectez réellement au canal, à la chaine « Alain, livre quatrième » et donc comprendre ou plutôt intégrer, assimiler de quoi il est question. Si la réponse est OUI alors vous savez parfaitement à quoi fait référence les landes arides puisque vous en sortez. Nous sommes ici en T2 et vous aurez noté cette phrase « Aussi faut-il être toujours plus fort que les preuves. »
Viafx24, le 24 juin 2025